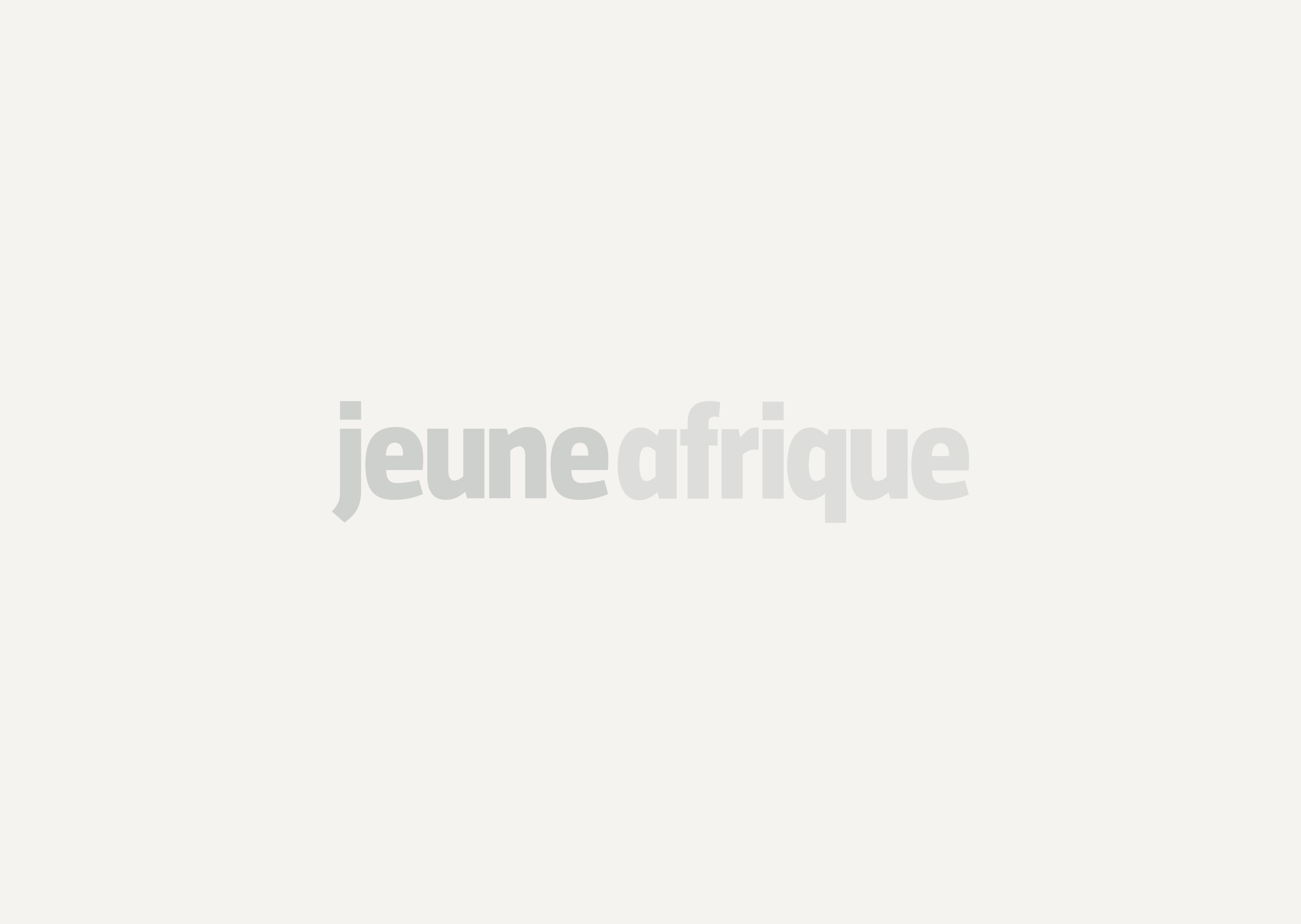En organisant le double scrutin du 22 mars malgré les affrontements qui en ont perturbé le déroulement et les réticences de la communauté internationale, Alpha Condé a maintenu coûte que coûte son calendrier. Un nouveau chapitre s’ouvre désormais pour le président guinéen : renouer le dialogue avec l’opposition et faire connaître sa décision sur une éventuelle candidature à un troisième mandat.
Dix ? Vingt ? Quel que soit le nombre de victimes des violences qui ont endeuillé le double scrutin du 22 mars, ce sont autant de morts de trop. Pour autant, le pire n’a pas eu lieu, en l’occurrence le scénario parfois annoncé d’une quasi-guerre civile entre un pouvoir campé sur ses certitudes et son agenda et une opposition déterminée à lancer contre lui l’assaut final, le tout sur fond d’affrontements ethniques généralisés.
Malgré les hésitations d’une partie de son entourage, dont certains membres ont fait défection ces derniers mois, le président Alpha Condé n’a rien changé à son chronogramme, si ce n’est un report de treize jours des législatives et du référendum, le temps d’une purge du fichier électoral par les experts de la Cedeao. Dimanche 22 mars, le décor d’une bataille générale était planté. On a eu droit à une succession d’escarmouches, hélas parfois sanglantes.
L’objectif annoncé du Front national de défense de la Constitution (FNDC) était de rendre le double scrutin impossible. Les saccages de bureaux de vote, conduisant au déplacement des urnes dans les mairies ou les préfectures, les intimidations, les attaques des domiciles de chefs de quartiers ou de militants du parti au pouvoir ainsi que les manifestations sur la voie publique faisaient partie de cette stratégie parfaitement assumée et publiquement revendiquée.
« Exit option »
Ce boycott actif qui, dans l’esprit de certains de ses promoteurs, visait à faire tomber le régime, a fonctionné dans une douzaine de préfectures sur les 33 que compte le pays et dans trois communes de Conakry sur cinq. Dans la capitale, Matoto et Dixinn ont été touchées, mais c’est pour l’essentiel à Ratoma, fief de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), qu’ont eu lieu les plus sérieux affrontements.
Dans l’intérieur du pays, la région du Fouta, où le parti de Cellou Dalein Diallo est solidement implanté, a clairement choisi l’« exit option », au besoin par la force. En Basse-Guinée, où l’Union des forces républicaines (UFR) de Sidya Touré réalise ses meilleurs scores, les localités de Boké et de Télimélé ont été le théâtre de protestations, tout comme celles de Yomou et de Nzérékoré (Guinée forestière).
Dans cette dernière préfecture, les heurts ethnico-confessionnels tragiques de 2013 entre Guerzés et Koniankés se sont répétés à un degré moindre, faisant plusieurs morts.
Avec une spécificité : le référendum sur la nouvelle Constitution n’a été ici qu’un prétexte, nombre d’autochtones guerzés estimant qu’aucun scrutin ne devait se dérouler en Guinée forestière en l’absence de celui qu’ils considèrent comme leur leader naturel, le capitaine (et ex-président) Moussa Dadis Camara. Lequel, en son exil de Ouagadougou, s’était pourtant abstenu de prendre parti dans le conflit entre Alpha Condé et ses opposants.
À noter enfin qu’une partie de la diaspora guinéenne, au sein de laquelle le FNDC est très actif, a organisé des manifestations parfois teintées de violences devant les ambassades de Guinée à Dakar, Freetown, Libreville et Londres.
L’exemple de l’opération Sentinelle
Contrairement à ce qui a été dit, l’armée guinéenne n’est pas directement intervenue dans le processus électoral.
Elle a cependant été déployée en tant que « force de troisième intervention » dans plusieurs localités du Fouta, à Conakry et à Nzérékoré « dans le but de disperser des foules hostiles et des factions civiles en conflit violent, de sécuriser certains édifices publics et lieux sensibles », selon le ministre de la Défense, Mohamed Diané, qui cite à titre d’exemple la mobilisation des troupes de l’ « opération Sentinelle », en France, pendant la crise des Gilets jaunes, en mars 2019.
Difficile de savoir si, à la différence des forces de police et de gendarmerie, en première ligne dans le maintien de l’ordre, lesquelles ont parfois fait usage d’armes létales, des militaires ont outrepassé leur fonction strictement républicaine encadrée par les lois de juin 2015.
Mise en avant par le FNDC et certaines ONG, la présence sur le terrain d’unités de la Garde présidentielle et des « bérets rouges » (parachutistes) est qualifiée de « fake news » à la présidence, où l’on minimise par ailleurs la portée de ce qui ressemble fort à une tentative de coup de force survenue le 20 mars, avant-veille du double scrutin, alors que l’opposant Cellou Dalein Diallo venait de lancer un appel à l’armée, l’exhortant à se mettre « du côté du droit » et non « au service de la dictature ».
Apprentis putschistes
Ce vendredi-là, un groupe d’une cinquantaine de militaires menés par un officier du génie, le commandant Pascal Zémi, fait irruption au camp Alpha Yaya, dans la banlieue de Conakry, lors d’un rassemblement de l’unité d’élite du Bata (Bataillon autonome des transports aéroportés) et tente de le rallier à sa cause. Objectif : s’emparer du palais présidentiel.
L’opération se heurtant à un refus, les apprentis putschistes essaient d’entraîner les soldats de faction au camp de l’armée de l’air. Nouvel échec.
Zémi et ses hommes prennent alors la fuite et se réfugient dans une villa de la baie de Kountia, où ils sont vite repérés et encerclés par les forces spéciales. Tous sont appréhendés, mais le major de garnison de la ville de Conakry, le colonel Ousmane Cissé, est tué lors de l’assaut.
Si l’hypothèse d’un putsch politiquement commandité et sérieusement organisé est écartée, cet incident n’en a pas moins contribué à crisper un peu plus encore la situation préélectorale.
Sans observateurs – ce qui en limite forcément la crédibilité internationale – et malgré de nombreuses perturbations, en particulier dans les fiefs de l’opposition, le double scrutin du 22 mars a donc eu lieu. Sa tenue marque en quelque sorte les limites de l’influence extérieure sur la Guinée.
Coûte que coûte
Persuadé que la France, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le président en exercice de la Cedeao, Mahamadou Issoufou, œuvraient de concert dans l’unique but de rendre caduc le référendum constitutionnel (lequel aurait été impossible à organiser après le 21 avril, le protocole additionnel de la Cedeao interdisant toute modification de la loi fondamentale six mois avant une élection présidentielle), Alpha Condé a maintenu coûte que coûte son calendrier.
Il a pour cela joué d’une carte souverainiste à laquelle certains pays non francophones, comme le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Rwanda ou l’Angola, sont sensibles et qui traverse également le débat autour du franc CFA : toute évolution politique et institutionnelle en Afrique doit se faire dans un cadre endogène, loin de toute pression « occidentale ».
À cet égard, les termes très secs du Quai d’Orsay, estimant le 24 mars que le « caractère non inclusif » du processus n’a pas permis « la tenue d’élections crédibles et dont le résultat puisse être consensuel », ont été largement compensés aux yeux de la présidence par ceux, moins intrusifs, de l’ambassade des États-Unis et surtout par le communiqué de la Cedeao du 25 mars, qui se contente de « prendre acte » du double scrutin, de condamner les violences qui ont émaillé son déroulement et de réitérer sa « totale disponibilité à faciliter le dialogue entre tous les acteurs ».
Quant au profond différend entre Alpha Condé et Mahamadou Issoufou, le second estimant que « les anciens leaders de la Feanf [Fédération des étudiants d’Afrique noire en France] doivent montrer l’exemple » et le premier pensant que, si son homologue nigérien ne brigue pas un troisième mandat, c’est moins par conviction que parce qu’il craint de subir le même sort que son prédécesseur Mamadou Tandja (renversé pour avoir nourri ce type de projet), sans doute faudra-t-il attendre la fin du mandat d’Issoufou à la tête de la Cedeao, dans trois mois, pour qu’il s’apaise quelque peu.
Quelles leçons ?
Les résultats des législatives, mais aussi et surtout du référendum constitutionnel n’étant pas encore connus à l’heure où ces lignes sont écrites, les leçons du 22 mars ne peuvent être que partielles.
Le FNDC, qui apparaît plus que jamais comme une coquille au sein de laquelle l’UFDG occupe l’essentiel de la place, est certes parvenu à perturber le double scrutin, mais pas à l’empêcher (sauf en certaines localités et circonscriptions). A-t-il cru trop vite que la messe était dite ?
Côté pouvoir, la régulation chaude a une fois de plus prévalu, autour d’un président certes à l’aise dans ce genre d’exercice, mais dont l’omniprésence et les initiatives incessantes ont pour effet de paralyser celles de ses collaborateurs.
Il faudra tout de même se demander pourquoi les législatives n’ont pas été organisées plus tôt alors que le mandat des députés a pris fin il y a deux ans, pourquoi malgré ce délai le contenu du dialogue politique n’a pas été épuisé, et surtout pourquoi Alpha Condé a laissé basculer dans les rangs de l’opposition des personnalités telles que Bah Oury et Sidya Touré – dans le cas de ce dernier, le président n’a pas su (ou pas voulu) réguler la rivalité qui l’opposait au Premier ministre, Kassory Fofana, et à l’un des influents conseillers à la présidence.
Renouer un dialogue inclusif avec une opposition qui ne reconnaît aucun des résultats (législatif et référendaire) du 22 mars ne sera certes pas une tâche aisée. Mais c’est indispensable, d’autant que des partis aussi implantés que l’UFDG et l’UFR se retrouveront de facto sans représentation nationale pendant cinq ans, ce qui n’est évidemment pas sain pour la démocratie.
Il faudra aussi renforcer les moyens de la commission électorale, réintroduire dans le fichier électoral les électeurs soustraits par les experts de la Cedeao pour ne pas s’être présentés au dernier enrôlement biométrique (ce qui n’en fait pas des électeurs fictifs), décrisper le climat politique en formant un gouvernement de large ouverture, essayer en somme de ressouder la fracture guinéenne en espérant, comme le demande la Cedeao, que « tous les acteurs politiques et de la société civile s’abstiennent de tout recours à la violence ».
L’élection présidentielle étant dans un peu plus de six mois, il faudra enfin qu’Alpha Condé se décide, ni trop tôt ni trop tard. Pour lui. Ou pour son dauphin.