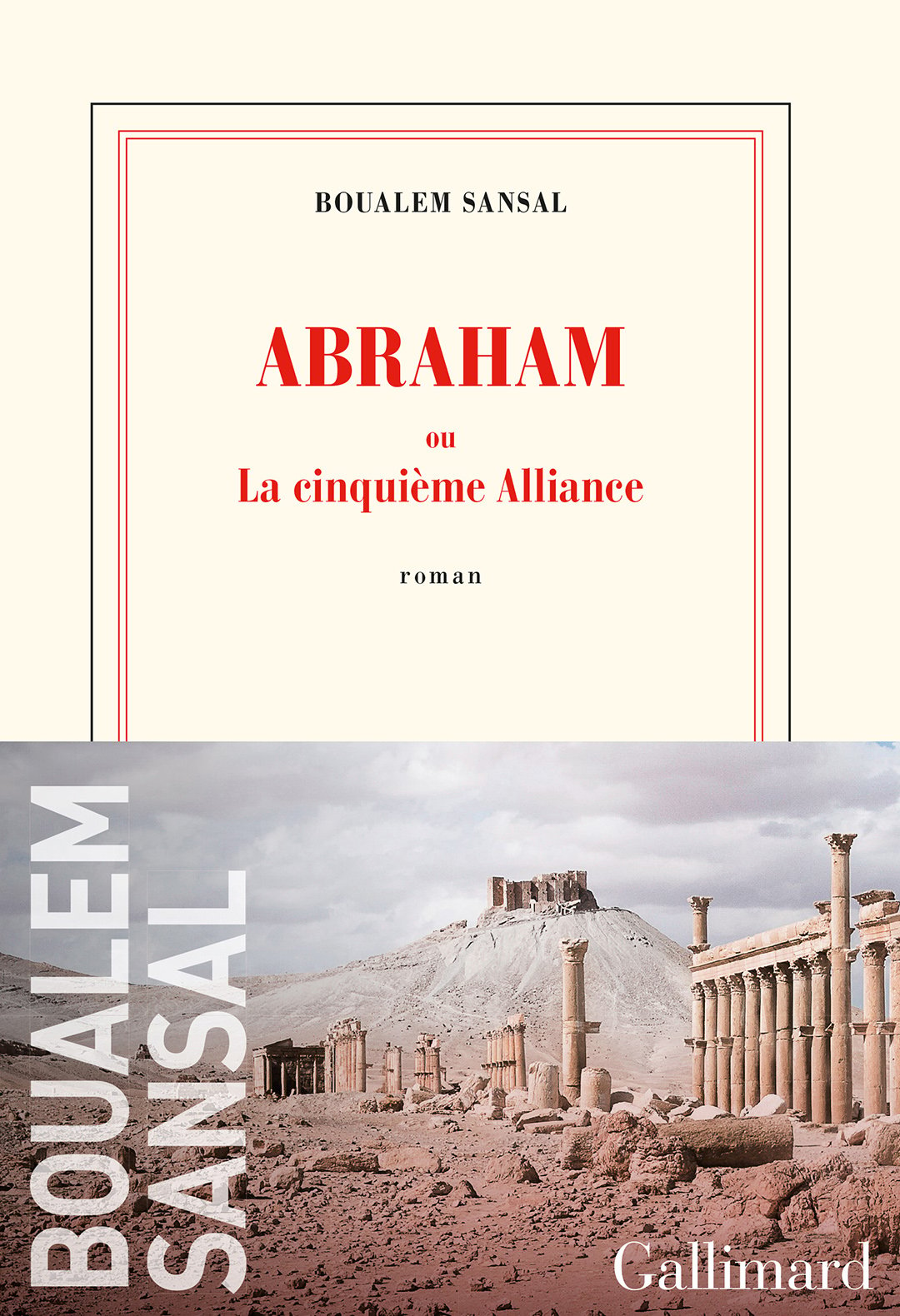Comme après les attentats de Charlie Hebdo, l’assassinat de Samuel Paty a suscité son lot de propositions pour renforcer l’enseignement de la laïcité à l’école : le président du groupe « Les Républicains » à l’Assemblée nationale, Damien Abad, a notamment réclamé l’instauration de « cours sur les valeurs de la République et la laïcité », sanctionnés par une épreuve obligatoire au brevet des collèges, ainsi qu’une « épreuve de laïcité dans le concours d’enseignant ».

Charles Mercier, Université de Bordeaux
Mais qu’en est-il vraiment des connaissances des enfants sur ce principe républicain qui garantit la neutralité de l’État et des agents en matière de convictions religieuses ?
Une notion bien identifiée
Une enquête menée à Bordeaux au printemps 2017 montre que les écoliers sont loin d’être muets sur la laïcité. Sur les 160 élèves de CM1 et de CM2 qui y ont participé, 81 % ont été capables de répondre à une partie au moins du questionnaire, alors même qu’il avait été convenu avec les enseignants que la notion ne serait pas abordée en classe avant l’enquête.
Contrairement à ce qu’on pourrait supposer spontanément, ce ne sont pas les élèves issus d’établissements favorisés et homogènes sur le plan culturel qui ont obtenu le meilleur score : les classes des écoles en situation de mixité sociale et ethnique étaient sur la première marche du podium, comme si la diversité de l’environnement scolaire fournissait des ressources pour écrire sur la laïcité.
D’un point de vue qualitatif, les élèves de l’école privilégiée ont davantage réussi à formuler une définition experte du concept, mais ceux des autres écoles ont fourni des exemples plus nombreux, plus concrets, et davantage ancrés dans un vécu personnel.
On rejoint ici une observation faite par Annick Percheron, alors qu’elle s’intéressait à la socialisation politique des enfants des milieux populaires : il n’étaient pas en retard par rapport aux enfants des milieux aisés car ils faisaient l’expérience directe des faits politiques et sociaux dans leur quotidien.
Une source d’interdits plus que de libertés
Si l’on s’intéresse aux contenus attribués à la laïcité, il est frappant de constater que les jeunes enquêtés conçoivent la laïcité comme une source d’interdictions davantage que comme un dispositif qui garantit des droits. « On n’a pas le droit » est l’expression qui revient le plus souvent sous leur plume.
Très majoritairement, les élèves s’appliquent à eux-mêmes, dans le cadre scolaire et parfois même dans l’ensemble de l’espace public, l’impératif de neutralité. Ignorant, sauf exception, la distinction opérée par la loi du 15 mars 2004 entre signes religieux discrets (autorisés) et signes ostensibles (interdits), ils considèrent que la laïcité implique l’absence de tout accessoire religieux dans l’enceinte de l’école : « on n’a pas le droit de montrer des signes qui pourraient faire penser les gens qu’on a une religion. »
Concernant la parole et les mots, les répondants sont unanimes à considérer que toute propagande est à proscrire (« Pour moi, la laïcité est l’interdiction de dire que sa religion est la meilleure et que les autres sont nuls »), mais sont partagés sur l’idée qu’on puisse converser, sans prosélytisme, de religion à l’école. Un quart des élèves répond négativement, un autre quart positivement tandis que la moitié restante élabore une casuistique fine en fonction :
- des lieux : « On peut pas trop en parler dans la cour, mais en classe on peut » ;
- des personnes : « tu peux parler de ta religion à tes amis ou à des gens à qui tu peux faire confiance » ;
- des circonstances : « des fois oui, des fois non parce que ça peut blessé des personnes mais des fois oui pour mieux connaître la personne ».
Il semble que, dans leur grande majorité, les élèves aient intégré ce que Stéphanie Hennette-Vauchez et Vincent Valentin qualifient de « nouvelle laïcité », qui, depuis le début des années 2000, cherche à étendre l’obligation de neutralité convictionnelle à l’ensemble de la société et non plus seulement à l’État.
Si certains élèves associent la laïcité à une liberté, c’est la liberté de conscience qui est convoquée, et non la liberté d’expression : « Pour moi, la laïcité, ces de pouvoir croire ou ne pas croire en un dieu spécial mais de ne pas le montrer. »
Une appréciation positive
Parmi les 59 % des élèves qui ont répondu à la dernière question du formulaire qui leur demandait d’évaluer la laïcité, près de 90 % ont porté une appréciation positive ou plutôt positive, 8 % une appréciation négative ou plutôt négative et 2 % n’ont pas exprimé de jugement de valeur. L’adhésion s’exprime par des formules souvent enthousiastes.
On peut expliquer ces résultats par le conformisme des enfants, qui cherchent à s’affilier et à ne pas commettre d’impair par rapport aux préférences qu’ils ont pu repérer chez les adultes. La laïcité étant un des mots clés de l’école, ils savent qu’il s’agit d’un item auquel ils peuvent et doivent accorder leur confiance. https://www.youtube.com/embed/gXJ0qqtroQ8?wmode=transparent&start=0 Discussion sur la laïcité avec des élèves de CM2, en 2019, sur France 3 Provence-Alpes Côte d’Azur.
La moitié des réponses exprimées sont argumentées. Plusieurs considèrent que la laïcité permet d’aller vers ceux qui sont différents (« grâce à ça, on est amies »), et de préserver l’égalité et la liberté de conscience des « plus petits ».
Les élèves qui ont défini la laïcité comme l’absence de toute trace de religion à l’école mettent en avant ses effets positifs pour la paix civile, déclinant à l’échelle de la cour de récréation les arguments qui circulent dans le monde des adultes pour vanter les mérites de l’invisibilité des convictions : « on ne se tape pas, on ne dit pas de gros mots et on ne se moque pas de la religion de quelqu’un, je pense que c’est génial. »
La conception stricte de la laïcité semble correspondre à l’appétence enfantine pour l’ordre, les règles et les cadres rassurants. Il faut néanmoins relever que pour la minorité qui a porté une appréciation négative, tout en manifestant sa loyauté, cette laïcité neutralisante est peu utile : « Je pense que ça ne sert pas à grand-chose mais je respecte quand même sa et je me fiche que mes amis soient juifs ou catholiques. »
Une formation à consolider
Les résultats de cette enquête exploratoire suggèrent qu’arrivés en fin d’école élémentaire, les élèves, même quand ils n’ont pas eu de cours spécifique sur la laïcité, ont acquis des représentations sur la notion, par confrontation aux normes, et par imprégnation des mots qu’elle génère dans leur environnement scolaire, mais sans doute aussi familial et médiatique.
Les enfants apparaissent particulièrement perméables aux discours qui, depuis le début des années 2000, renégocient le sens du mot, le corrélant non plus à la liberté d’expression en matière de foi, mais à l’encadrement de la visibilité du religieux dans l’espace public.
L’idée d’une formation renforcée et systématisée des élèves, mais aussi des enseignants, qui souvent sont contraints à « bricoler » individuellement un discours légitimant ce qu’ils pensent être interdit à l’école, paraît dès lors pertinente. Elle permettrait de confronter les représentations issues des « nouveaux vocabulaires de la laïcité » au cadre juridique d’un dispositif plus libéral et inclusif qu’il n’y paraît.
Charles Mercier, Maître de conférences HDR en histoire contemporaine, Université de Bordeaux
This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.